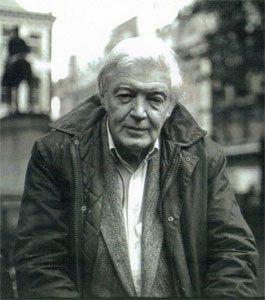
Par Colin Ward
Introduction
Par Les Obscurs
Nous avons publié ce texte en anglais l’année dernière et en proposons ici une traduction. Colin Ward (1924-2010) est considéré comme un des principaux théoriciens de l’anarchisme en Angleterre dans la seconde moitié du XXème siècle. Sa conception de l’état s’inscrit dans une continuité avec Proudhon, Bakounine, Kropotkine, Landauer et Buber. Son livre principal sur ce sujet est « Anarchy in Action, 1973 – 2008 » qui n’est pas traduit. A titre d’introduction générale, on peut lire en français « David Goodway, L’Anarchie en société – Conversation avec Colin Ward, 2005, Atelier de création libertaire ». Le texte proposé ici sous le titre « L’anarchie et l’état » est la traduction du premier chapitre de « Anarchy in Action », intitulé « Anarchy and the State ».
Nous ne sommes pas sûrs de suivre tout-à-fait Colin Ward dans la torsion qu’il applique à la conception de l’état de Landauer, à partir du commentaire de Buber. Ward donne à penser que « l’état comme relation », thèse fondamentale de Landauer, serait expliquée ou prolongée, par la théorie du « surplus de puissance » de l’état sur la société, proposée par Buber, et finalement par « le fait que chaque peuple se sente menacé par les autres ». Nous lisons ce passage comme une des interprétations possibles de Landauer, mais peu convaincantes, d’autant plus que Buber qui consacre à Landauer un chapitre très important, n’en parle pas dans ce passage.
Autrement dit, le texte de Ward a, selon nous, un double mérite. D’une part, il présente de manière solide les thèses classiques de l’anarchisme sur l’état: l’action directe, l’autonomie, le contrôle ouvrier, la décentralisation et la fédération. D’autre part, il a le mérite d’intègrer (en 1973) Landauer à ce « corpus » de l’anarchisme. En revanche, nous restons sur notre faim lorsqu’il s’agit de comprendre la portée de la thèse de Landauer sur l’état comme relation, y compris ses effets sur la théorie anarchiste classique de l’état.
L’anarchie et l’état
Par Colin Ward
Tant que les problèmes d’aujourd’hui sont posés en termes de politique de masse et d’« organisation de masse », il est clair que seuls les États et les partis de masse peuvent les résoudre. Mais si les solutions qui peuvent être proposées par les États et les partis existants sont reconnues comme futiles ou mauvaises, ou les deux, alors nous devons rechercher non seulement des « solutions » différentes, mais surtout une manière différente de poser les problèmes eux-mêmes.
Andrea Caffi
Si vous considérez l’histoire du socialisme et réfléchissez au triste écart entre promesse et réalité, aussi bien dans les pays où les partis socialistes ont triomphé dans la lutte pour le pouvoir politique que dans ceux où ils ne l’ont jamais atteint, vous vous demanderez forcément ce qui n’a pas fonctionné, quand et pourquoi. Certains verraient dans la révolution russe de 1917 le tournant fatal de l’histoire du socialisme. D’autres considéreraient la révolution de février 1848 à Paris comme « le point de départ du double développement du socialisme européen, anarchiste et marxiste » [1] , tandis que beaucoup situeraient le point critique de divergence dans le congrès de l’Internationale de La Haye en 1872, lorsque l’exclusion de Bakounine et des anarchistes signifia la victoire du marxisme.
Dans l’une de ses critiques prophétiques de Marx cette année-là, Bakounine prévoyait toute l’histoire ultérieure de la société communiste :
« Marx est un communiste autoritaire et centralisateur. Il veut ce que nous voulons, le triomphe complet de l’égalité économique et sociale, mais il le veut dans l’État et à travers le pouvoir d’État, à travers la dictature d’un gouvernement provisoire très fort et, pour ainsi dire, despotique, c’est-à-dire par la négation de la liberté. Son idéal économique est l’État, seul propriétaire de la terre et de toutes sortes de capitaux, cultivant la terre sous la direction d’ingénieurs d’État et contrôlant toutes les associations industrielles et commerciales avec le capital de l’État. Nous voulons le même triomphe de l’égalité économique et sociale à travers l’abolition de l’État et de tout ce qui passe sous le nom de droit (qui, à nos yeux, est la négation permanente des droits de l’homme). Nous voulons que la reconstruction de la société et l’unification de l’humanité soient réalisées, non pas de haut en bas, par une quelconque autorité, ni par des fonctionnaires socialistes, des ingénieurs et d’autres hommes de science accrédités, mais de bas en haut, par la libre fédération de toutes sortes d’associations ouvrières libérées du joug de l’État. » [2]
La variété anglaise du socialisme a atteint plus tard un point de bifurcation. L’un des premiers Fabian Tracts a pu déclarer en 1886 que:
« Le socialisme anglais n’est pas encore anarchiste ou collectiviste, ni suffisamment défini en termes politiques pour être classé. Il existe un ensemble de sentiments de type socialiste mais qui ne se reconnaissent pas encore comme socialistes. Mais lorsque les socialistes inconscients d’Angleterre prendront conscience de leur position, ils se diviseront probablement eux aussi en deux partis : un parti collectiviste soutenant une administration centrale forte et un parti anarchiste en contrepoids défendant l’initiative individuelle contre cette administration. »[3]
Les Fabiens ont rapidement trouvé de quel côté ils se situaient et, lorsqu’un parti travailliste fut fondé, ils exercèrent une influence décisive sur sa politique. Lors de sa conférence annuelle en 1918, le Parti travailliste s’est finalement engagé dans cette interprétation du socialisme qui l’identifiait à l’augmentation illimitée du pouvoir et de l’activité de l’État à travers sa forme choisie : l’entreprise publique géante contrôlée par la direction de l’état.
Et quand le socialisme a accédé au pouvoir, qu’a-t-il créé effectivement ? Un capitalisme monopolistique avec un vernis de protection sociale comme substitut à la justice sociale. Les grands espoirs du XIXe siècle ne se sont pas réalisés ; seules les sombres prophéties se sont réalisées. La critique de l’État et de la structure de son pouvoir et de son autorité formulée par les penseurs anarchistes classiques a gagné en validité et en urgence au cours du siècle de la guerre totale et de l’État total, tandis que la foi dans la conquête du pouvoir d’État amenait cet avènement de la guerre totale et de l’État total. Le socialisme a été détruit dans tous les pays où les partis socialistes ont remporté une majorité parlementaire, ou sont arrivés au pouvoir sur la vague d’une révolution populaire, ou ont été installés par les chars soviétiques. Ce qui s’est produit est exactement ce que l’anarchiste Proudhon avait annoncé il y a plus de cent ans. Tout ce qui a été réalisé, c’est:
« …une démocratie compacte ayant l’apparence d’être fondée sur la dictature des masses, mais dans laquelle les masses n’ont pas plus de pouvoir qu’il n’en faut pour assurer un servage général conformément aux préceptes et principes suivants empruntés au vieil absolutisme : indivisibilité du pouvoir public, centralisation dévorante, destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative et régionale (considérée comme perturbatrice), police inquisitoriale. » [4]
Kropotkine nous avertissait également que « l’organisation de l’État, ayant été la force à laquelle les minorités ont eu recours pour établir et organiser leur pouvoir sur les masses, ne peut pas être la force qui servira à détruire ces privilèges », et il a déclaré que « la libération économique et politique de l’homme devra créer de nouvelles formes d’expression dans la vie, à la place de celles établies par l’État. »[5]
Il pensait qu’il allait de soi que « cette nouvelle forme devra être plus populaire, plus décentralisée , et plus proche de l’autonomie populaire que ne pourra jamais l’être le gouvernement représentatif », réaffirmant que nous serons obligés de trouver de nouvelles formes d’organisation pour les fonctions sociales que l’État remplit à travers la bureaucratie, et que « tant que cela ce n’est pas fait, rien ne sera fait ».[6]
Lorsque nous regardons l’impuissance de l’individu et du collectif dans le monde d’aujourd’hui et que nous nous demandons pourquoi ils sont impuissants, nous devons non seulement répondre qu’ils sont faibles en raison des vastes concentrations de pouvoir dans le monde moderne, militaro-industriel, mais qu’ils sont faibles parce qu’ils ont cédé leur pouvoir à l’État. C’est comme si chaque individu possédait une certaine quantité de pouvoir, mais que par défaut, par négligence, ou par habitude ou conditionnement irréfléchi et sans imagination, il avait permis à quelqu’un d’autre de le récupérer, plutôt que de l’utiliser lui-même à ses propres fins. (Selon Kenneth Boulding, » il n’y a qu’une quantité limitée d’énergie humaine. Lorsque les grandes organisations utilisent ces ressources énergétiques, elles sont drainées des autres sphères. »)[7]
Gustav Landauer, l’anarchiste allemand, a apporté une contribution profonde et simple à l’analyse de l’État et de la société en une phrase :
« L’État n’est pas quelque chose qui peut être détruit par une révolution, mais une condition, une certaine relation entre les êtres humains, un mode de comportement humain ; nous le détruisons en contractant d’autres relations, en nous comportant différemment. »
C’est nous, et non une identité extérieure abstraite, laisse entendre Landauer, qui nous comportons d’une manière ou d’une autre, politiquement ou socialement. L’ami et exécuteur testamentaire de Landauer, Martin Buber, commence son essai « Entre la société et l’état » par une observation du sociologue Robert MacIver, selon laquelle « Mettre sur le même plan le social et le politique, c’est se rendre coupable de la plus grossière de toutes les confusions, qui obture complètement la compréhension aussi bien de la société que de l’État ». Le principe politique, pour Buber, se caractérise par le pouvoir, l’autorité, la hiérarchie, la domination. Il voit le principe social partout où les hommes s’unissent dans une association fondée sur un besoin ou un intérêt commun.
Qu’est-ce qui, demande Buber, donne au principe politique son ascendant ? Et il répond :
« Le fait que chaque peuple se sente menacé par les autres donne à l’État la force unificatrice décisive; il s’appuie lui-même sur l’instinct d’auto-conservation de la société; la situation de crise externe latente lui permet de surmonter la situation intérieure … Toutes les formes de gouvernement ont ceci en commun : chacune possède plus de pouvoir que ne l’exigent les conditions données ; cet excès de capacité d’intervention est en fait ce que nous entendons par pouvoir politique. La mesure de cet excès, qui ne peut bien entendu être calculée avec précision, représente la différence exacte entre l’administration et le gouvernement. »
Il appelle cet excès le « surplus politique » et observe que « sa justification découle de l’instabilité externe et interne, de l’état de crise latent entre les nations et au sein de chaque nation. Le principe politique est toujours plus fort par rapport au principe social que ne l’exigent les conditions données. Le résultat est une diminution continue de la spontanéité sociale. » [8]
Le conflit entre ces deux principes est un aspect permanent de la condition humaine. Ou comme le dit Kropotkine : « Tout au long de l’histoire de notre civilisation, deux traditions, deux tendances opposées ont été en conflit : la tradition romaine et la tradition populaire, la tradition impériale et la tradition fédéraliste, la tradition autoritaire et la tradition libertaire. » Il existe une corrélation inverse entre les deux : la force de l’un est la faiblesse de l’autre. Si nous voulons renforcer la société, nous devons affaiblir l’État. Les totalitaires de tous bords en sont conscients, c’est pourquoi ils cherchent invariablement à détruire les institutions sociales qu’ils ne peuvent pas dominer. Il en va de même pour les groupes d’intérêt dominants dans l’État, comme l’alliance des grandes entreprises et de l’establishment militaire pour « l’économie de guerre permanente » suggérée par le secrétaire à la Défense Charles E. Wilson aux États-Unis, qui est depuis devenue si dominante que même Eisenhower , dans son dernier discours en tant que président, s’est senti obligé de nous avertir de sa menace. [9]
Dépouillé de la métaphysique dont les hommes politiques et les philosophes l’ont enveloppé, l’État peut être défini comme un mécanisme politique utilisant la force et, pour le sociologue, il est une forme parmi d’autres d’organisation sociale. Elle se « distingue cependant de toutes les autres associations par son investissement exclusif dans le pouvoir final de coercition ». [10] Et contre qui ce pouvoir final est-il dirigé ? Elle est dirigée contre l’ennemi extérieur, mais elle vise la société soumise à l’intérieur.
C’est pourquoi Buber a déclaré que c’est le maintien de la crise externe latente qui permet à l’État de prendre le dessus dans les crises internes. Est-ce une procédure consciente ? Est-ce simplement que des hommes « méchants » contrôlent l’État, afin que nous puissions arranger les choses en votant pour des hommes « bons » ? Ou s’agit-il d’une caractéristique fondamentale de l’État en tant qu’institution ? C’est parce qu’elle tirait cette conclusion finale que Simone Weil déclarait :
« La grande erreur de presque toutes les études sur la guerre, erreur dans laquelle sont tombés tous les socialistes, a été de considérer la guerre comme un épisode de politique étrangère, alors qu’elle est surtout un acte de politique intérieure, et l’acte le plus atroce de tous : car tout comme Marx a constaté qu’à l’ère du capitalisme effréné, la concurrence entre employeurs, ne connaissant d’autre arme que l’exploitation de leurs travailleurs, se transformait en une lutte de chaque employeur contre ses propres ouvriers, et finalement de l’ensemble de la classe patronale contre ses employés, de la même manière l’État utilise la guerre et la menace de guerre comme une arme contre sa propre population. Puisque l’appareil dirigeant n’a pas d’autre moyen de combattre l’ennemi qu’en envoyant sous la contrainte ses propres soldats à la mort, la guerre d’un Etat contre un autre Etat se résout en une guerre de l’ État et de l’appareil militaire contre son propre peuple. » [11]
Bien entendu, les choses ne se présentent pas de cette façon si vous faites partie de l’appareil dirigeant, calculant quelle proportion de la population vous pouvez vous permettre de perdre dans une guerre nucléaire – tout comme les gouvernements de toutes les grandes puissances, capitalistes et communistes, l’ont calculé. Mais c’est effectivement le cas si vous faites partie de la population sacrifiable – à moins que vous n’identifiez votre propre carcasse sans importance à l’appareil d’État – comme le font des millions de personnes. Le facteur « dépense humaine » a augmenté en étant transféré du personnel militaire spécialisé, rare et coûteux à la population civile amorphe. Les stratéges américains ont calculé la proportion de civils tués dans les grandes guerres de ce siècle. Durant la Première Guerre mondiale, 5 % des personnes tuées étaient des civils, pendant la Seconde Guerre mondiale 48 %, pendant la guerre de Corée 84 %, tandis que lors d’une Troisième Guerre mondiale, 90 à 95 % seraient des civils. Les États, grands et petits, disposent désormais d’un stock d’armes nucléaires équivalent à dix tonnes de TNT pour chaque personne vivante aujourd’hui.
Au XIXe siècle, T. H. Green faisait remarquer que la guerre était l’expression d’un État « imparfait », mais il avait tout à fait tort. La guerre est l’expression de l’État dans sa forme la plus parfaite : c’est son heure la plus belle. La guerre est la santé de l’État — l’expression a été inventée pendant la Première Guerre mondiale par Randolph Bourne, qui a expliqué :
« L’État est l’organisation du troupeau pour agir de manière offensive ou défensive contre un autre troupeau organisé de manière similaire. La guerre envoie le stimulus des objectifs et des activités jusqu’au niveau le plus bas du troupeau et jusqu’à ses branches les plus reculées. Toutes les activités de la société sont liées le plus rapidement possible à cet objectif central d’une offensive ou d’une défense militaire, et l’État devient ce qu’il a vainement tenté de devenir en temps de paix: les courants divergents s’estompent et la nation avance lourdement et lentement, mais avec une vitesse et une intégration toujours plus rapides, vers la grande fin, vers cette paix d’être en guerre… » [12]
C’est pourquoi l’affaiblissement de l’État, le développement progressif de ses imperfections, est une nécessité sociale. Le renforcement d’autres loyautés, de foyers de pouvoir alternatifs, de différents modes de comportement humain est essentiel à la survie. Mais par où commencer ? Il devrait être évident que nous ne commençons pas par soutenir, rejoindre ou espérer changer de l’intérieur les partis politiques existants, ni par en créer de nouveaux en tant que prétendants rivaux au pouvoir politique. Notre tâche n’est pas d’acquérir le pouvoir, mais de l’éroder, de l’expulser de l’État.
« La bureaucratie d’État et la centralisation sont aussi inconciliables avec le socialisme que l’autocratie l’était avec le régime capitaliste. D’une manière ou d’une autre, le socialisme doit devenir plus populaire, plus communautariste et moins dépendant d’un gouvernement indirect par l’intermédiaire de représentants élus. Il doit devenir plus autonome. »[13]
En d’autres termes, nous devons construire des réseaux plutôt que des pyramides. Toutes les institutions autoritaires sont organisées en pyramides. L’État, l’entreprise privée ou publique, l’armée, la police, l’église, l’université, l’hôpital : ce sont toutes des structures pyramidales, avec un petit groupe de décideurs au sommet, et une large base de personnes auxquelles échappent les décisions qui les concernent au bas de l’échelle. L’anarchisme n’exige pas le changement des étiquettes sur les niveaux, il ne veut pas que des personnes différentes soient au sommet, il veut que nous grimpions par le bas. Il préconise un réseau étendu d’individus et de groupes, prenant leurs propres décisions et contrôlant leur propre destin.
Les penseurs anarchistes classiques envisageaient l’ensemble de l’organisation sociale tissée à partir de tels groupes locaux : la commune ou le conseil comme noyau territorial, qui n’est « pas une branche de l’État, mais la libre association des membres concernés, qui peut être une coopérative ou une union corporative, ou simplement une union provisoire de plusieurs personnes unies par un besoin commun » [14]), et le syndicat ou le conseil ouvrier comme unité industrielle ou professionnelle. Ces unités se fédéreraient non pas comme les pierres d’une pyramide où le plus gros fardeau est supporté par la couche la plus basse, mais comme les maillons d’un réseau, le réseau des groupes autonomes. Plusieurs courants de pensée sont liés dans la théorie sociale anarchiste : les idées d’action directe, d’autonomie et de contrôle ouvrier, de décentralisation et de fédéralisme.
L’expression « action directe » a été utilisée pour la première fois par les syndicalistes révolutionnaires français du début du siècle et a été associée aux diverses formes de résistance industrielle militante – la grève, le ralentissement, la grève du zèle, le sabotage et la grève générale. Sa signification s’est élargie depuis pour englober, par exemple, l’expérience de la campagne de désobéissance civile de Gandhi et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, ainsi que les nombreuses autres formes de politique du « Do-it yourself » qui se répandent dans le monde. L’action directe a été définie par David Wieck comme « l’action qui, par rapport à une situation, réalise le but souhaité, dans la mesure où cela relève de son pouvoir ou du pouvoir de son groupe » et il la distingue de l’action indirecte qui réalise un objectif non pertinent, voire contradictoire, soit disant comme moyen d’atteindre la « bonne » fin. Il en donne cet exemple simple :
« Si le boucher pèse sa viande avec le pouce sur la balance, on peut s’en plaindre et lui dire que c’est un bandit qui vole les pauvres, et s’il persiste et qu’on ne fait rien d’autre, cela ce n’est qu’un discours ; on peut appeler le Département des Poids et Mesures, et c’est une action indirecte ; ou encore, sans parler, insister pour peser sa propre viande, emporter une balance pour vérifier le poids du boucher, emmener ses affaires ailleurs, aider à ouvrir un magasin coopératif, et ce sont des actions directes. »
Wieck observe que :
« En partant de la conviction que dans chaque situation, chaque individu et chaque groupe a la possibilité d’agir directement à un certain niveau de généralité, nous pouvons découvrir beaucoup de choses qui ont été méconnues et l’importance de beaucoup de choses qui ont été sous-estimées. Notre pensée est si politisée, si centrée sur les mouvements des institutions gouvernementales, que les effets des efforts directs visant à modifier son environnement sont inexplorés. L’habitude de l’action directe est peut-être identique à l’habitude d’être un homme libre, prêt à vivre de manière responsable dans une société libre. »[15]
Les idées d’autonomie, de contrôle ouvrier et de décentralisation sont indissociables de celle d’action directe. Dans l’État moderne, partout et dans tous les domaines, un groupe de personnes prend des décisions, exerce un contrôle, limite les choix, tandis que la grande majorité doit accepter ces décisions, se soumettre à ce contrôle et agir dans les limites de ces choix imposés de l’extérieur. L’habitude de l’action directe est l’habitude de leur reprendre le pouvoir de prendre des décisions qui nous affectent.
L’autonomie du travailleur au travail est le domaine le plus important dans lequel cette expropriation de la prise de décision peut s’appliquer. Lorsqu’on évoque le contrôle ouvrier, les gens sourient tristement et murmurent avec regret qu’il est dommage que l’ampleur et la complexité de l’industrie moderne en fassent un rêve utopique qui ne pourrait jamais être mis en pratique dans une économie développée. Ils ont tort. Il n’existe aucune raison technique de considérer le contrôle ouvrier comme impossible. Les obstacles à l’autogestion dans l’industrie sont les mêmes qui s’opposent à toute forme de partage équitable des biens de la société : l’intérêt direct des privilégiés dans la répartition actuelle du pouvoir et de la propriété.
De même, la décentralisation n’est pas tant un problème technique qu’une approche des problèmes d’organisation humaine. Des arguments convaincants peuvent être avancés en faveur de la décentralisation sur des bases économiques, mais pour l’anarchiste, il n’existe tout simplement pas d’autre solution compatible avec son plaidoyer en faveur de l’action directe et de l’autonomie. Il ne lui vient pas à l’esprit de rechercher des solutions centralisatrices, tout comme il ne vient pas à l’esprit d’une personne ayant un cadre de pensée autoritaire et centralisateur de rechercher des solutions décentralisées. Un anarchiste contemporain, défenseur de la décentralisation, Paul Goodman, remarque que :
» En fait, la pensée décentraliste a toujours eu deux courants. Certains auteurs, par ex. Lao-tseu ou Tolstoï font une critique paysanne conservatrice de la cour et de la ville centralisées comme étant inorganiques, verbales et rituelles. Mais d’autres auteurs, par ex. Proudhon ou Kropotkine font une critique urbaine démocratique de la bureaucratie et du pouvoir centralisés, y compris du pouvoir industriel féodal, en les qualifiant d’initiative exploiteuse, inefficace et décourageante. Dans notre époque actuelle de socialisme d’État, de féodalité d’entreprise, d’école enrégimentée, de lavage de cerveau par les communications de masse et d’anomie urbaine, les deux types de critiques ont du sens. Nous devons restaurer à la fois l’autonomie paysanne et le pouvoir démocratique des corporations professionnelles et techniques. Toute décentralisation qui pourrait avoir lieu aujourd’hui serait inévitablement post-urbaine et post-centraliste : elle ne saurait être provinciale… » [16]
Sa conclusion est que la décentralisation est « une sorte d’organisation sociale ; il ne s’agit pas d’un isolement géographique, mais d’un usage sociologique particulier de la géographie ».
Précisément parce qu’il ne s’agit pas de recommander l’isolement géographique, les penseurs anarchistes ont consacré une grande réflexion au principe du fédéralisme. Proudhon le considérait comme l’alpha et l’oméga de ses idées politiques et économiques. Il ne pensait pas à une confédération d’États ou à un gouvernement fédéral mondial, mais à un principe fondamental de l’organisation humaine.
La philosophie du fédéralisme de Bakounine faisait écho à celle de Proudhon, mais insistait sur le fait que seul le socialisme pouvait lui donner un contenu véritablement révolutionnaire. Kropotkine, lui aussi, s’appuyait sur l’histoire de la Révolution française, de la Commune de Paris et, à la toute fin de sa vie, sur l’expérience de la Révolution russe, pour illustrer l’importance du principe fédéral si l’on veut qu’une révolution conserve son contenu révolutionnaire.
L’action directe autonome, la prise de décision décentralisée et la fédération libre ont été les caractéristiques de tous les soulèvements véritablement populaires. Staughton Lynd a fait remarquer qu’« aucune véritable révolution n’a jamais eu lieu — que ce soit en Amérique en 1776, en France en 1789, en Russie en 1917, en Chine en 1949 — sans des institutions populaires ad hoc improvisées d’en bas, commençant simplement à administrer le pouvoir à la place des institutions, auparavant reconnues comme légitimes. On les a également vues lors des soulèvements allemands de 1919, comme la « république-conseil » de Munich, dans la révolution espagnole de 1936 et dans la révolution hongroise de 1956, ou au printemps de Prague en 1968 – pour ensuite être détruites par le même parti qui est arrivé au pouvoir en 1917 grâce au slogan essentiellement anarchiste « Tout le pouvoir aux soviets ». En mars 1920, alors que les bolcheviks avaient transformé les soviets locaux en organes de l’administration centrale, Lénine dit à Emma Goldman : « Pourquoi, même votre grand camarade Errico Malatesta s’est déclaré pour les soviets. « Oui », a-t-elle répondu, « pour les soviets libres ». Malatesta lui-même, définissant l’interprétation anarchiste de la révolution, a écrit :
« La révolution est la destruction de tous les liens coercitifs ; c’est l’autonomie des groupes, des communes, des régions, la révolution est la libre fédération provoquée par le désir de fraternité, par les intérêts individuels et collectifs, par les besoins de production et de défense ; la révolution est la constitution d’innombrables groupements libres fondés sur les idées, les désirs et les goûts de toutes sortes qui existent parmi le peuple. La révolution est la formation et la dissolution de milliers d’organismes représentatifs, de district, communaux, régionaux, nationaux qui, sans aucun pouvoir législatif, servent à faire connaître et à coordonner les désirs et les intérêts de gens proches ou éloignés,et lointains et qui agissent au moyen de l’information, du conseil et de l’exemple. La révolution est la liberté éprouvée au creuset des faits — et dure aussi longtemps que dure la liberté, c’est-à-dire jusqu’à ce que d’autres, profitant de la lassitude qui s’empare des masses, des inévitables déceptions qui suivent les espoirs exagérés, des erreurs probables et des fautes humaines, parviennent à constituer un pouvoir qui, appuyé par une armée de mercenaires ou de conscrits, fait la loi, arrête le mouvement au point où il est parvenu, puis déclenche la réaction ». [17]
La dernière phrase indique qu’il pensait que la réaction était inévitable, et c’est le cas lorsque les gens sont prêts à abandonner le pouvoir qu’ils ont arraché à une ancienne élite dirigeante entre les mains d’une nouvelle. Mais une réaction à toute révolution est inévitable dans un autre sens. C’est ce qu’implique le flux et le reflux de l’histoire. La lutte finale n’existe que dans les paroles d’une chanson. Comme le dit Landauer, chaque période après la révolution est une période avant la révolution pour tous ceux dont la vie ne s’est pas enlisée dans un grand moment du passé. Il n’y a pas de lutte finale, seulement une série de luttes partisanes sur différents fronts.
Et après plus d’un siècle d’expérience de la théorie et plus d’un demi-siècle d’expérience de la pratique des variétés marxistes et social-démocrates du socialisme, après que les historiens ont rejeté l’anarchisme comme l’une des variables de l’histoire du XIXe siècle, elle réapparaît comme une philosophie sociale cohérente dans la guérilla pour une société de participants, qui se déroule sporadiquement partout dans le monde. Ainsi, commentant les événements de Mai 1968 en France, Théodore Draper déclarait-il :
« La lignée des nouveaux révolutionnaires remonte à Bakounine plutôt qu’à Marx, et c’est tout aussi bien que le terme « anarchisme » redevienne à la mode. Car ce à quoi nous assistons est une renaissance de l’anarchisme en tenue moderne ou déguisé en marxisme des derniers jours. Tout comme le marxisme du XIXe siècle a mûri dans une lutte contre l’anarchisme, le marxisme du XXe siècle devra peut-être se recréer dans une autre lutte contre l’anarchisme sous sa dernière forme. » [18]
Il a ajouté que les anarchistes n’avaient pas montré beaucoup d’endurance au XIXe siècle et qu’il était peu probable qu’ils en aient beaucoup plus au cours de ce siècle. Qu’il ait ou non raison à propos des nouveaux anarchistes dépend d’un certain nombre de facteurs. Premièrement, la question de savoir si les gens ont appris ou non quelque chose de l’histoire des cent dernières années ; deuxièmement, la question de savoir si le grand nombre de personnes à l’Est comme à l’Ouest – les jeunes insatisfaits et dissidents de l’empire soviétique ainsi que des États-Unis qui recherchent une théorie alternative de l’organisation sociale – comprendront la pertinence des idées que nous définissons comme anarchisme; et troisièmement, si les anarchistes eux-mêmes sont suffisamment imaginatifs et inventifs pour trouver des moyens d’appliquer aujourd’hui leurs idées à la société dans laquelle nous vivons d’une manière qui combine les objectifs immédiats et les fins ultimes.
Sources (adaptées par nous LesObscurs)
[1] Vaclav Cerny, “The Socialistic Year 1848 and its Heritage”, The Critical Monthly, Nos. 1 and 2 (Prague, 1948).
[2] Michel Bakounine, “Lettre aux Internationalistes de Romagne” 28 janvier 1872
[3] Fabian Tract No 4, « What Socialism Is » (London, 1886).
[4] Pierre-Joseph Proudhon, « De la capacité politique des classes ouvrières » (Paris, 1864).
[5] Pierre Kropotkine, « La science moderne et l’anarchie » (Paris, 1913).
[6] Pierre Kropotkine, « La science moderne et l’anarchie » (Paris, 1913).
[7] George Benello, “Wasteland Culture”, Our Generation, Vol. 5, No. 2, (Montreal, 1967)
[8] Martin Buber, “Utopie et socialisme » (1952), L’Échappée, 2016. L’essai « Entre la société et l’état » a été intégré au livre par Buber, comme chapitre 12.
[9] Fred J Cook, « The Warfare State » (London, 1963).
[10] MacIver and Page, « Society » (London, 1948).
[11] Simone Weil, “Réflexions sur la Guerre”, La Critique Sociale n°10, (Paris, 1933).
[12] Randolph Bourne, « The State », 1919, Resistance Press, (New York, 1945).
[13] Pierre Kropotkine, op. cit.
[14] Camillo Bernen, « Kropotkin, His Federalist Ideas » (London, 1943).
[15] David Wieck, “The Habit of Direct Action”, Anarchy 13 (London, 1962), repris dans Colin Ward (ed.), « A Decade of Anarchy », (London, Freedom Press, 1987).
[16] Paul Goodman, « Like a Conquered Province » (New York, 1967).
[17] Vernon Richards (ed.), « Malatesta: His Life and Ideas » (London, Freedom Press, 1965).
[18] Theodore Draper in Encounter, août 1968.
Origine du texte traduit
« Anarchy and the state »
https://lesobscurs.wordpress.com/2022/12/09/anarchy-and-the-state/
Le texte est tiré de :
Colin Ward, Anarchy in Action https://theanarchistlibrary.org/library/colin-ward-anarchy-in-action
Site : The Anarchist Library https://theanarchistlibrary.org/special/index
Avec la mention suivante : First published 1973 by George Allen & Unwin Ltd. This edition, with a new introduction, published by Freedom Press 84b Whitechapel High Street London E17QX 1982, reprinted 1996. ISBN 0 900384 20 4. In Memory of Paul Goodman 1911 — 1972
